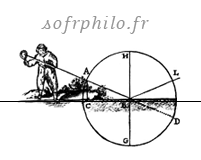Déclarations et hommages de la Société française de philosophie
Sommaire
- Après les 7, 8 et 9 janvier 2015 (février 2015)
- ''In memoriam'' Bernard Mabille (29 novembre 2014)
- Hommage à Jean-François Mattéi (24 mars 2014)
- Hommage à Jacques D'Hondt (10 février 2012)
- Déclaration sur la culture générale et les humanités dans l'enseignement (octobre 2009)
- Texte de soutien à Robert Redeker (octobre 2006)
Déclaration après les assassinats des 7, 8 et 9 janvier 2015
" La Société française de philosophie partage l'émotion suscitée dans le monde entier par les assassinats du 7 janvier à Charlie Hebdo, du 8 janvier à Montrouge et du 9 janvier à l'Hyper Cacher. Des artistes et des juifs ont été assassinés parce qu'ils étaient des artistes et parce qu'ils étaient des juifs, un professeur et un médecin ont été assassinés parce qu'ils étaient épris de liberté de pensée, des policiers ont été assassinés parce qu'ils défendaient un État laïque, et des malheureux ont été assassinés parce qu'ils se trouvaient là.
Mais la Société française de philosophie ne peut pas se contenter de déplorer ces morts absurdes. Ces crimes ont été commis au nom d'une religion, au nom de l'islam. Fidèle à sa tradition multiséculaire d'examen critique de ses croyances par chaque conscience libre, la Société française de philosophie invite ardemment les intellectuels de culture musulmane à développer publiquement la critique d'une telle justification religieuse de menées criminelles contre la liberté qu'est l'esprit et que tout citoyen français a le devoir absolu de défendre.
La Société française de philosophie appelle de ses vœux que les Lumières de l'islam s'allument depuis la France. Alors, oui, nous serons vraiment tous Charlie. "
In Memoriam Bernard Mabille, par Elisabeth Kessler (29 novembre 2014)
De quel amour blessé Bernard Mabille s'en est-il donc allé, si loin et si violemment séparé de nous ? On a retrouvé son corps sans vie devant l'Institut de philosophie, à Poitiers, au petit matin du jour où les professeurs devaient faire leur rentrée des classes, le 1er septembre 2014. Mais n'était-ce pas lui qui nous avait appris à reconnaître dans la philosophie un geste (1), à la fois comme comportement et comme dit ? Comment pourrait-il en aller autrement de ce geste ultime, par lequel il montre à tout jamais leur borne aux noirs vols du blasphème ? Mabille nous avait bien averti que le problème de la totalité est celui de son principe, et donc aussi, éventuellement, celui de son anarchie. Tel est le fil tendu dès sa grande thèse sur Hegel, " L'épreuve de la contingence ", parue en 1999 (2). Dans son préambule, avant d'ouvrir la carte où il reporterait " les lieux " de la caducité (Zufälligkeit), il nous confiait à demi-mot (p. 11), l'existence de ce mal secret qui le rongeait déjà.
Il semble que la pensée de Mabille tournoie autour de l'énigme du sensible comme porteur de l'idéal de la raison, même si ces termes kantiens ne seraient peut-être pas les siens. Sa pensée ne pouvait manquer de prendre au moins l'une de ses sources dans le dialogue avec des poètes, tels Jacques Dupin (3) ou Stig Dagermann (4), dans l'œuvre desquels on doit aussi apercevoir des kindred spirits. Mais ce n'est pas là qu'elle a commencé ; peut-être plutôt d'abord dans un engagement politique, là même où sa mort nous laissera. En 1994 (5), Mabille a commenté les §§ 315 à 318 des Principes de la philosophie du droit à propos de ce que doit être et de ce qui doit être pensé de l'opinion publique, seul milieu où la liberté immémoriale de l'esprit ait à se déployer, par l'effort obscur de toute part, vers ce qui l'alimente et le fait croître ensemble, en le faisant devenir esprit concret. Non, le Hegel de Mabille ne fut pas celui de Kojève, ni celui des administrateurs naguère si soucieux de " préparer une opinion à accepter des décisions prises sans elle " (p. 189). Mais si la subjectivité moderne doit être approuvée parce qu'elle n'accepte rien qui ne soit " justifié ", elle est digne de mépris si son seul critère est la satisfaction de la particularité individuelle. Par son contenu, l'opinion touche à la profondeur du principe substantiel ; par sa forme, elle est alourdie par tout ce qu'elle a de particulier et qui fait d'elle la première figure, peut-être la plus épouvantable, de la contingence.
Mabille a défendu Hegel, en sa liberté de penseur spirituel, contre la pesanteur où l'entraînait le pieux et invétéré psittacisme de ses commentateurs, lequel fut bien utile aussi à ses adversaires, plus prompts à débiter leurs fadaises qu'à lire avec soin le philosophe qu'ils avaient choisi comme repoussoir. On ne peut toutefois réprimer le souci d'une correspondance étrange entre le geste accompli par Mabille pour mourir et celui de Deleuze, encore si près de nous. Mais peut-être la mémoire de Jules Lequier est-elle une ombre plus importante encore aux alentours de toutes ces disparitions. N'est-ce pas le risque majeur depuis Socrate : être emporté par la violence qui fait rage depuis toujours entre le Philosophe et la Cité ?
Mais le Hegel de Mabille reste le penseur de la liberté aux prises avec l'existence ; c'est là que certaines filiations secrètes avec la pensée de Schelling sont les plus visibles. Certes, Mabille sera fidèle au dictat de Hegel concernant le Schelling de l'identité en cette fameuse nuit où " toutes les vaches sont grises ". Mais si Mabille ne semble pas avoir évoqué la première esquisse, chez Schelling, du geste hégélien, il ne saurait l'avoir ignorée, et c'est une joie de reconnaître jusque dans le style impeccable et limpide de ses phrases classiques, le secret d'une formation que Schelling avait prise pour foyer de tout son intérêt philosophique.
Une telle énigme ne commence peut-être ni avec Leibniz seulement, ni même avec Jakob Böhme, mais remonte sans discontinuer jusqu'à la Grèce de Socrate et Platon (6). Tel est le deuxième grand " battant ", au sens des deux montants verticaux d'une fenêtre " à la française ", de l'œuvre de Mabille : la confrontation avec la pensée de Heidegger.
Cette confrontation a lieu d'abord pour conjurer une dernière fois les ultimes calomniateurs de Hegel, qui, le sachant ou non, s'autorisaient en fait de la pensée de Heidegger pour développer leurs propres concaténations de " pensées d'entendement ". Loin de tout face à face immédiat, le second grand livre de Mabille consiste à " intensifier deux lectures internes par le défi aporétique qu'apporte la position de tiers "(7). Aurions-nous jamais pu retrouver la signature de Mabille ailleurs qu'en ce geste inoubliable de défi, en vue d'une constitution ? Et sous le titre de constitution, l'enjeu n'est-il pas clairement d'aider à discerner le bien commun, celui qui est en débat quand il s'agit de délibérer avec prudence ? Une constitution (Verfassung) désigne ce qui, aujourd'hui, dans tous les domaines, nous fait le plus grave défaut : un contenant essentiel (Fass), une capacité qui nous permette de vivre et donc de penser ensemble. La métaphysique doit nous permettre de repenser au principe, en tant que réminiscence, et aussi en tant qu'invention, comme Mabille nous l'aura si clairement enseigné dans sa lecture de Hegel. Et sur ce point, nous ne pouvons plus répéter, avec cette équivoque si particulière à Heidegger, que " tous les philosophes ont pensé le même, et que c'est pour cela que leur pensée est en conflit " (8).
Contre Heidegger, Mabille nous enseigne à lire la tradition autrement que pour " en libérer l'impensé ", c'est-à-dire autrement que sur un mode dogmatique (p. 370). " La relation avec la tradition est une libération ", écrit Mabille. Il s'agit de distinguer deux conceptions différentes du temps : l'une, celle de Hegel, correspond au primat du présent ; l'autre, celle de Heidegger, au primat de " l'avènementiel ". L'une nous permet de penser l'unité de la pensée humaine, l'autre au contraire nous l'interdit. Le problème central concerne donc le sens de l'histoire, celle des hommes et aussi celle de la philosophie. Heidegger au fond, replie Hegel sur Leibniz en l'accusant d'éliminer la temporalité " dans un processus historique qui n'est que la forme narrative de l'éternité " (9). Hegel au contraire fait de la temporalité " le milieu de la présentation du vrai " (10), et c'est avec le sens de cette limite essentielle que Mabille s'explique.
Mabille écrivait en faveur d'une nouvelle constitution de la métaphysique, par un geste où nous devons reconnaître celui de la liberté philosophique autant que du courage politique et simplement humain. Comment ne pas souhaiter qu'une telle œuvre témoigne toujours et pour le plus grand nombre en faveur de la philosophie éternelle qu'elle aura servie avec une telle liberté ?
- Philosophie première et pensée principielle, in Le Principe, éd. B. Mabille, Vrin, 2006, p. 18, n.2.
- Rééd. en 2013, chez Hermann.
- Une pensée singulière. Mélanges offerts à J.F. Marquet, éd. P. David et B. Mabille, l'Harmattan, 2003.
- Stig Dagermann ou les Incertitudes d'un engagement, sous le pseudonyme de Georges Überschlag, revue Germanica, 1992.
- Le Pouvoir, éd. Bernard Mabille et J.C. Goddard, 1994.
- Bernard Mabille, Hegel, Heidegger et la métaphysique, Recherches pour une constitution, Vrin, 2004, passim et en particulier p. 37.
- Hegel, Heidegger et la métaphysique, Recherches pour une constitution, p. 28.
- Identität und Differenz : "L'affaire de la pensée est ce qui en soi est le litigieux d'un litige, das in sich Strittige eines Streites"). Et aussi : Schelling, Niemeyer Verlag, Tübingen, 1995, p. 15.
- Hegel, Heidegger et la métaphysique, Recherches pour une constitution, Paris, Vrin, 2004, p. 368.
- Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, § 14.
Jean-François Mattéi
24 mars 2014. Nous apprenons avec une grande tristesse le décès de Jean-François Mattéi, professeur émérite à l'université de Nice-Sophia Antipolis et membre de l'Institut universitaire de France.
La conférence qu'il devait donner devant la Société, initialement programmée le 22 mars, avait pour titre "Du réel au virtuel : Platon et la modélisation des simulacres". C'est avec un souvenir ému que nous convions les visiteurs de ce site à lire ou à relire ci-dessous la présentation argumentée qu'il nous avait fournie pour l'annonce de la conférence.
On lira à la suite le bel hommage que lui rend Bernard Bourgeois, président d'honneur de la SFP.
La SFP présente à Mme Mattéi et à tous ses proches ses sincères condoléances.
Jean-François Mattéi. Du réel au virtuel : Platon et la modélisation des simulacres
"Paul Valéry disait de la caverne de Platon qu'elle était la plus grande chambre noire jamais réalisée. Mais l'auteur de La République et du Timée n'est pas seulement le précurseur de la photographie et du cinéma qui diffusent leur flux incessant d'images. Il est le penseur qui a ordonné la structure mimétique du monde en distinguant les trois niveaux du modèle idéal, de la copie-icône et de la copie-idole. Or, notre temps semble supprimer cette hiérarchie et justifier la révolte des images. Censées représenter le réel, comme des icônes, elles se sont mises à le simuler, comme des simulacres, au point de le subvertir pour constituer des mondes virtuels et autonomes. Gilles Deleuze saluait dans ce processus fantasmatique " la plus innocente de toutes les destructions, celle du platonisme ". L'avènement des simulacres constituerait ainsi le renversement de la hiérarchie entre la réalité et ses images instituée il y a 2 500 ans par Platon.
Jean Baudrillard a reconnu également, cette fois pour la dénoncer, " la précession des simulacres " qui aboutit à la simulation d'un monde hyperréel dans lequel la copie précède le modèle, comme si la carte précédait le territoire au point de se substituer à lui. Il rejoignait par là l'intuition platonicienne selon laquelle les images tirent leur statut équivoque, non pas de leur propre simulation, mais d'une modélisation primitive. Loin que les réalisations actuelles de la science et de la technique témoignent d'une victoire des simulacres, en premier lieu au cinéma, la virtualisation des images révèle la primauté des modèles rationnels. C'est ce triple jeu permanent de la modélisation, de la représentation et de la simulation qui permet à la modernité tardive, non pas de renverser le platonisme, comme le répètent à l'envi les déconstructeurs de la métaphysique, mais d'en établir paradoxalement la vérité. Platon reste irréfutable."
Hommage à Jean-François Mattéi, par Bernard Bourgeois, président d'honneur de la Société française de philosophie, 25 mars 2014
Jean-François Mattéi vient de nous quitter, emporté par la brutalité de la maladie. Méditerranéen - né en 1941 à Oran - il le fut aussi par son constant séjour marseillais et son enseignement à l'université de Nice, même à travers l'exercice de ses nombreuses responsabilités nationales dans l'institution universitaire (il était membre de l'Institut universitaire de France et dirigea les Volumes III et IV de l'Encyclopédie philosophique universelle : Les œuvres philosophiques, Le Discours philosophique). Mais sa pensée elle aussi, celle d'un métaphysicien attaché à fonder ou refonder sur l'être les manifestations culturelles de l'humanité, tentées de s'égarer dans le nihilisme des simulacres, s'ancra dans l'ontologie méditerranéenne du Sophiste platonicien (L'Etranger et le simulacre, 1983), se rappelant à elle-même, sur le tard, chez Nietzsche et Heidegger (L'ordre du monde, 1989). Alors, la grande alliance, sous la justice de la transcendance, de celle-ci et de la belle immanence, du Ciel et de la Terre, des dieux et des mortels, ordonna toute la culture européenne, dont le regard théorique et critique universel, plénier, jugea toutes les choses humaines, et d'abord les cultures. Mais la raison moderne, croyant s'universaliser et s'absolutiser en intégrant en elle son Autre - auparavant rejeté hors d'elle - se relativisa et se repentit en se faisant essentiellement critique d'elle-même. Se coupant de la transcendance de l'être, elle se fragmenta et détruisit dans tous les domaines, de la philosophie à la politique, laissant place au chaos, au désordre, à l'immonde, à la barbarie (La barbarie intérieure, 1999 ; Le regard vide, 2007). Cependant, le monde aura le dernier mot, et si, à la tombée du jour, les prétendants modernes à la philosophie tendent encore la coupe à Socrate, le platonisme ne pourra pas ne pas revenir, car la seule fin digne de la pensée est bien le retour à l'origine. Dans une telle foi, indignons-nous, certes (De l'indignation, 2005), mais hors de toute posture simplement négative, dans l'affirmation primaire de la dignité de l'homme, qui tient avant tout, conclut Mattéi reprenant Platon, à sa faculté d'admiration. Célébrant avec éclat la grande convergence platonicienne, dans l'Être, du vrai, du beau et du Bien, Jean-François Mattéi a pratiqué et illustré la philosophie, dans l'enthousiasme, mais aussi avec courage, comme le chemin vers la sagesse.
***********
Hommage à Jacques D'Hondt, par Bernard Bourgeois
Jacques D'Hondt, décédé le 10 février 2012, fut président de la Société française de philosophie : son hommage est publié sur la page Historique et finalité de ce site
***********
Déclaration de la Société française de philosophie sur la culture générale et les humanités dans l'enseignement
(octobre 2009). En téléchargement format PDF
La suppression envisagée de l'épreuve de culture générale dans nombre de concours de recrutement de la fonction publique (ou même sa limitation) expose la nécessaire démocratisation de l'enseignement et de l'accès à des charges publiques à un risque de grave perversion. Cette perversion consiste en un populisme culturel jugeant en fait les enfants du peuple incapables de soutenir les exigences de l'élévation au-dessus de soi constitutive de la vraie culture. Une telle libération spirituelle des situations réelles, natives ou acquises (pratiques coutumières ou connaissances transmises), toujours particulières, s'opère à travers leur relativisation, à effet critique, par la culture générale. Celle-ci permet alors à chaque homme de s'universaliser et, en devenant ainsi en lui-même l'Homme, de mieux s'accorder avec les autres hommes.
Assurément, la culture générale n'est une culture réelle que si, en premier lieu, elle se nourrit de la réalité particulière des formations et disciplines spéciales, scientifiques ou techniques, au plus loin d'un bavardage formel. Et que si, en second lieu, elle se définit par une assomption actuelle des trésors offerts par l'humanité passée. Mais ce souci d'une réalisation présente d'elle-même fait que son effort d'unification ou synthèse d'un esprit de plus en plus spécialisé et dispersé, au sein d'un monde en proie à une complexification accélérée, est de plus en plus indispensable et doit être de plus en plus intense. Ce n'est donc pas moins, mais plus de culture générale qu'il faut insérer dans la formation.
Il le faut notamment dans la formation initiale des lycées, et cela d'autant que les enseignements traditionnels de culture générale qui la couronnaient dans ce que l'on appelait autrefois les classes de rhétorique et de philosophie y ont été réduits. Ils constituaient une véritable propédeutique secondaire à l'enseignement supérieur. Cette propédeutique serait à recréer, dans les conditions du présent. Et, celles-ci étant ce qu'elles sont, sans doute serait-il bon de la prolonger et d'en redoubler les heureux effets en rétablissant aussi, au début des études supérieures, une propédeutique proprement universitaire scellant la continuité, à travers leur stimulante différence alors maîtrisée, de deux étapes essentielles de l'unique formation de l'esprit.
Puisque, si la pensée se réalise dans les savoirs, toujours déterminés, ceux-ci ne progressent que par la pensée, toujours universalisante, la réduction de la culture générale, accoutumance systématique à l'acte de penser, bien loin de favoriser l'intégration culturelle, compromettrait donc à la fois le développement de la culture et celui du savoir.
La Société française de philosophie tient donc à rappeler que tout enseignement, s'il veut rester un opérateur de liberté, est nécessairement lié à la culture générale et aux humanités. Prises au sens large, qui concerne aussi les sciences et les techniques, les humanités désignent des parcours où, en apprenant des choses et des idées, on s'instruit en même temps de la pensée qui en rend la saisie possible. Sous prétexte que trop d'enfants ne maîtrisent pas bien l'oralité d'une langue maternelle, faut-il que l'école se borne au parler nourricier et renonce à toute langue littéraire ? Sous prétexte de rendre habile au calcul, faut-il renoncer à enseigner la démonstration ? Sous prétexte de faire entendre la prose, faut-il rendre sourd au vers ? Sous prétexte d'étudier les choses, faut-il priver la pensée de sa propre réflexion ? Il faut au contraire réaffirmer l'inverse : sans l'étrangeté de la langue littéraire, il n'y a plus de langues, mais des idiomes ; sans démonstration, il n'y a plus de mathématiques, mais des procédés ; sans le vers, la prose elle-même devient inaudible ; et une pensée qui renonce à se penser n'est plus une pensée.
***************
Soutien de la Société française de philosophie à Robert Redeker
Le Conseil d'administration de la Société française de philosophie s'est réuni le 14 octobre 2006 et a voté le texte suivant à l'unanimité, adressé à M. le Président de la République et envoyé à la presse :
Un homme est aujourd'hui menacé de mort, forcé depuis des semaines de se cacher pour avoir écrit et publié son point de vue. Il se trouve qu'il est professeur de philosophie. Or, il n'a fait qu'user du droit de tout citoyen. La question est de sauvegarder, à travers sa vie et celle de ses proches, la liberté de pensée, d'opinion, d'expression et de communication dans un Etat de droit.
La Société française de philosophie apporte son soutien à Robert Redeker et souhaite que les pouvoirs publics prennent à cet égard toutes leurs responsabilités.
Réponse de la Présidence de la République
Nous avons reçu une réponse de la part de l'Elysée, datée du 26 octobre et signée par Mme Blandine Kriegel, Chargée de mission auprès du Président de la République.
En voici un extrait substantiel:
Le Président de la République, qui a lu avec beaucoup d'attention la motion de la Société française de philosophie, comprend et partage votre souci et m'a demandé de vous apporter les précisions suivantes.
Il considère comme vous qu'il est essentiel que les libertés de pensée, d'opinion, d'expression et de communication soient conservées et garanties dans un Etat de droit. C'est pourquoi le Ministre de l'Education nationale, Gilles de Robien, a été amené à réaffirmer ce principe de liberté d'opinion et d'expression. Le ministre a demandé au Recteur de l'Académie de Toulouse d'exprimer son soutien à M. Redeker et de suivre avec une grande attention la situation dans l'établissement où il a été nommé.
En ce qui concerne la sécurité de M. Redeker, qui est un droit fondamental auquel le Président est extrêmement attaché, plusieurs démarches ont été entreprises par le Ministre de l'Intérieur, démarches évidemment discrètes comme celles qui on trait à la sécurité des personnes, mais dont vous avez pu mesurer le souci de vigilance puisque les médias eux-mêmes se sont faits l'écho d'un courrier envoyé par internet qui faisait objet de recherche.
Le Ministre de l'Education nationale, qui a appelé personnellement Robert Redeker pour lui dire également son soutien, a veillé évidemment à ce qu'il soit dispensé d'un enesignement effectif et que son salaire lui soit intégralement versé et ce tant que lui-même estimera être l'objet de menaces.
Le Président de la République partage donc votre souci et demeure très attentif à ce que les pouvoirs publics, notamment le Ministère de l'Education nationale et le Ministère de l'Intérieur, prennent toutes leurs responsabilités.