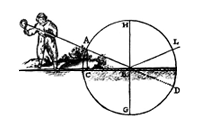« L’homme existe-t-il ? Existence et métaphysique », par Jean-Christophe Bardout
« L’homme existe-t-il ? Existence et métaphysique »
conférence par Jean-Christophe Bardout, professeur à l’université de Rennes
Samedi 22 novembre 2025
La période qui s’inaugure avec les Méditations métaphysiques de Descartes (1641-1642) et s’achève avec les Rêveries du promeneur solitaire (1776-1778) déploie plusieurs significations de l’existence.
Une première acception, héritée des spéculations médiévales, pense l’existence comme la cause, désormais devenue efficiente, ou comme l’effet de celle-ci : exister, c’est être causé, posée hors de sa cause, ou, pour mieux dire, être exposé.
Issue du Cogito cartésien (Ego sum, ego existo), une seconde acception de l’existence, bientôt dominante, l’entend à partir de la pensée, c’est-à-dire de la conscience de soi diversement affectée : dès lors, exister, c’est sentir, selon la parole du Vicaire savoyard. Exister, c’est aussi être senti, dans la mesure où toute existence se manifeste comme affection du sujet percevant. L’existence s’est ainsi doublement imposée : elle prend désormais le pas sur les autres acceptions de l’être, à commencer par l’essence, la substance, ou encore le possible. En second lieu, tout étant advient à l’existence, dans la mesure où son apparaître réside en l’esprit percevant. En ce sens, toute existence est inhérente à l’esprit, selon un modèle récurrent. Le moi sentant et sensible devient le modèle de tout existant.
Toutefois, l’homme ne saurait revendiquer l’exclusive de la sensibilité, qu’il partage analogiquement avec l’animal, voire la plante, à un moindre degré. La présente conférence voudrait donc ouvrir une autre piste, en vue de confirmer cet accomplissement anthropologique de l’existence, en une direction cependant différente. À partir de l’analyse pascalienne du divertissement et de l’imagination, de la théorie malebranchiste de l’inquiétude et de la distinction rousseauiste de l’être de l’homme naturel et de son existence sociale, travaillée par l’amour propre et l’imagination, il s’agit de mettre au jour une entente de l’exister comme être hors de soi, résolument libérée de son fondement égologique, et de le saisir à partir de descriptions concrètes de la condition humaine.