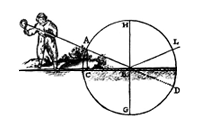Prix de la Revue de métaphysique et de morale
Afin d’encourager la soumission d’articles de recherche en français hors appel à contribution thématique, la Société française de philosophie crée le Prix de la Revue de métaphysique et de morale. … Lire la suite