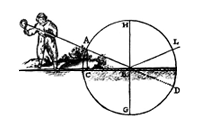Sur l’acrasie – deux conférences du 18 mars 2023 par M. Betzler et L. Jaffro
I. Laurent Jaffro (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : « L’acrasie : irrationalité ou immoralité ? »
Dans le débat sur l’acrasie, on entend par « jugement du meilleur », ou « meilleur jugement », un jugement personnel selon lequel, tout bien considéré, il est meilleur d’agir ainsi qu’autrement. Comment est-il possible qu’une personne agisse intentionnellement contre son meilleur jugement alors qu’elle croit être libre de le suivre et que rien ne l’en empêche ? Tel est le problème théorique de l’acrasie, dans la formulation que Donald Davidson a fixée. Il existe aussi un problème pratique de l’acrasie, celui de ses remèdes : comment éviter d’agir contre son meilleur jugement, en particulier si on est chroniquement disposé à agir ainsi ? Je considère seulement le problème théorique.
Dès les premières formulations de Platon dans le Protagoras, avant qu’Aristote ne lui donne son nom, il est clair que l’acrasie constitue un problème de rationalité pratique. Le « meilleur que… » est un « apparemment meilleur que… » et n’a pas de sens spécialement moral. Davidson, qui veillait à en donner les exemples les plus triviaux et les moins moraux possible, s’intéressait à la question parce qu’elle est un défi pour une théorie de la rationalité subjective : une telle conduite est irrationnelle dans la mesure où elle s’écarte du jugement tout bien considéré de l’agent. Cette irrationalité met à mal des principes qui sont inégalement partagés par les philosophes : la théorie causale de l’action, qui implique, comme le dit Davidson, que les raisons les plus fortes sont aussi les causes les plus fortes ; ou le principe, plus consensuel, selon lequel on désire et on agit sub specie boni, ici sous l’apparence du meilleur.
Pourtant, la tentation est forte de moraliser le problème de l’acrasie, de trois manières. D’abord, des principes moraux de l’agent peuvent être trahis dans son action. Ensuite, il semble assez naturel de penser que l’acrasie est particulièrement fâcheuse lorsque l’action acratique est moralement blâmable, de la même façon que la procrastination est d’autant plus préoccupante que l’action différée est importante. Enfin, une disposition chronique à agir contre son meilleur jugement pointe dans la direction d’un manque de contrôle de soi qui ressemble à un vice.
Je discute ces trois manières de moraliser le problème théorique de l’acrasie et conduis une enquête sceptique sur les conditions de possibilité d’une immoralité interne à l’acrasie.
II. Monika Betzler (Ludwig-Maximilians-Universität, Munich) : « Acrasie inverse et rationalité diachronique »
On emploie l’expression « acrasie inverse » pour décrire certains cas où un agent agit à l’encontre de son « meilleur jugement » en raison d’une émotion. Cette acrasie est dite inverse du fait qu’agir selon cette émotion semble être en fin de compte ce qu’il fallait faire, ce qu’il y avait de plus raisonnable ou de plus rationnel à faire. Cependant, parce que l’agent a agi contre son meilleur jugement tout en continuant d’y adhérer, son action reste bel et bien acratique.
Les cas d’acrasie inverse représentent un défi philosophique : comment peut-il être juste, raisonnable ou rationnel d’agir d’une façon qui va à l’encontre de son meilleur jugement, et que l’agent lui-même considère comme mauvaise ou erronée au moment d’agir ? Ou bien, pour le dire autrement, comment cela pourrait-il ne pas être raisonnable, rationnel ou juste, alors que l’action que l’agent a accomplie en raison de son émotion semble effectivement être la meilleure conduite qu’il pouvait adopter ?
Pour illustrer ce cas de figure, je reprends l’exemple d’Huckleberry Finn, le personnage de Mark Twain, qui écoute son cœur malgré son meilleur jugement : il ne livre pas aux autorités l’esclave en fuite qu’est son compagnon Jim.
Tout d’abord, je précise les conditions à remplir pour qu’on puisse considérer qu’une action suscitée par une émotion contrevenant à notre jugement est à la fois acratique et rationnelle : (i) l’action menée doit être intentionnelle ; et (ii) l’émotion en question, qui conduit à l’action, doit être suffisamment liée à l’agent pour que l’action ne se présente pas comme un cas de chance rationnelle.
Je montre ensuite que ni la conception standard, selon laquelle l’acrasie est un paradigme d’irrationalité, ni certaines propositions récentes, qui tentent de décrire les cas d’acrasie inverse comme rationnels, ne satisfont pleinement ces conditions.
Ce qu’il est rationnel de faire dans les situations où nous éprouvons des émotions contraires à notre jugement, c’est de réexaminer ce jugement, puis de le réviser ou de le réaffirmer à la lumière de nos émotions. Il s’ensuit que les cas d’acrasie inverse en tant que tels ne peuvent être qualifiés de rationnels. En revanche, de tels cas soulignent que lorsque nous éprouvons des émotions contraires à notre jugement, nous avons des raisons de réexaminer notre meilleur jugement afin de maintenir l’« enkrasia » sur la durée. Même si les cas d’acrasie inverse sont irrationnels sur le plan synchronique, ils nous enseignent à rester rationnels sur le plan diachronique.
Télécharger “Exempliers-Betzler-Jaffro-Acrasie-18-mars-2023.pdf” Exemplier-Jaffro-Betzler_SFPh_Mars18_23.pdf – Téléchargé 297 fois – 189,37 Ko