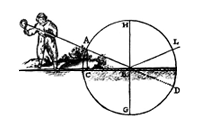L’acte esthétique (par Baldine Saint Girons)
Conférence du 19 janvier 2008 par Baldine Saint Girons Parler d’acte esthétique, c’est vouloir habiliter et rendre visible ce que nous appellerons « le travail esthétique » , plutôt que le sentiment … Lire la suite