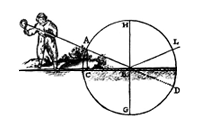Aussi loin que je remonte dans ma mémoire, en particulier lorsque j’évoque mes premiers travaux universitaires et mes engagements associatifs, je peux difficilement distinguer ce qui relevait de ma propre initiative ou ce qui répondait à une suggestion d’André Robinet, de sorte que, voulant parler de lui, je suis amené à parler de moi, ce qui est une manière bien peu appropriée de lui rendre hommage. Je crois avoir rencontré pour la première fois André Robinet dans les années soixante, lors d’une tournée de conférences que lui avait organisé au Maroc l’association Rives Méditerranéennes dont le président était alors le philosophe Mohamed-Aziz Lahbabi et dont j’étais le secrétaire général. Je venais de déposer mon sujet de thèse sur les sources françaises de la philosophie de Kant et d’emblée il s’intéressa à mes travaux de jeune chercheur en me donnant les conseils les plus judicieux, par exemple d’aller à Bonn consulter le professeur Gottfried Martin qui dirigeait une équipe chargée de relever les occurrences des noms propres et bientôt de tous les termes contenus dans les œuvres complètes de Kant, éditées par l’Académie de Berlin. Cette aide fut décisive et me fit gagner un temps précieux. André était à l’époque membre du conseil d’administration de la Fédération internationale de sociétés de philosophie. Il m’incita à participer à son XVIe congrès à Vienne en Autriche en 1968, (il se tint au moment de l’invasion par les chars russes de la Tchécoslovaquie) et d’y présenter une communication que je fis sur les œuvres des philosophes français, présentes à la mort de Kant dans sa bibliothèque. Après la séance, il me dit que j’étais tout désigné pour lui préparer le volume sur Kant qu’il avait programmé pour la collection qu’il avait créée chez Seghers, Philosophes de tous les temps dans laquelle lui-même a fait paraître un Leibniz, un Jaurès, un Bergson… Ce fut mon premier ouvrage publié et je lui en fus toujours très reconnaissant. Il avait le souci permanent, et combien amical, de faire apparaître mon nom dans ses travaux, par exemple dans les Œuvres complètes de Malebranche dont il dirigeait la publication chez Vrin et pour lesquelles il me demanda une note brève sur Kant et Malebranche ou encore de lui remettre une lettre originale que je possédais pour son édition de la Correspondance de Bergson aux Presses universitaires de France. Il voulait associer ceux qui lui étaient proches, de quelque façon que ce soit, même très modestement, à ses nombreuses recherches. J’ai de multiples exemples de cette sollicitation d’André Robinet auprès de collègues et d’amis, des membres de son Equipe de Recherche au C.N.R.S., du Centre d’Histoire des Sciences et des Doctrines, de mon épouse même. A la fois généreux et efficace, il les incitait à entreprendre avec audace, à oser s’adresser à la personne compétente qui faciliterait leur recherche et il les suivait ensuite dans leurs démarches.
Secrétaire général de l’Association des sociétés de philosophie de langue française (ASPLF) depuis 1980, mais actif bien avant, il m’associa progressivement à ses activités. C’est ainsi que je participai au congrès de Genève sur le langage dès 1966, à celui de Trois-Rivières en 1984 sur la création, à celui d’Athènes en 1986 sur l’avenir où il fut décidé que j’organiserais le congrès suivant sur l’espace et le temps en 1988 à Dijon où je fus élu vice-président de l’ASPLF et où j’ai fondé la Société d’études kantiennes de langue française à laquelle il ne cessa de s’intéresser et d’en suivre les travaux. Entre ces deux congrès, je lui avais apporté un concours modeste pour l’organisation du colloque du cinquantenaire dont il avait pris l’initiative avec les autorités québécoises : Cinquante ans de philosophie française, qui eut lieu à la Sorbonne en 1987. En 1996, au congrès de Paris, Jacques d’Hondt souhaitant se retirer de la présidence de l’Association, me proposa de lui succéder. Il me semblait que cette fonction revenait à André mais il refusa, considérant qu’il était plus important pour l’association qu’il reste secrétaire général-trésorier, fonction qu’il conserva jusqu’au congrès de 2004 dont l’organisation fut confiée à la Société Nantaise de Philosophie et à la préparation duquel il contribua efficacement. À mon grand regret, il renonça à y participer, remettant alors son mandat par une lettre qu’il m’adressa et que j’ai précieusement gardée. Il y fut élu membre à vie du conseil d’administration. Ce qui était une modeste façon de lui signifier la reconnaissance de l’ASPLF à l’égard pour toutes les tâches qu’il y avait remplies. Il en avait été la mémoire et la source active de la plupart de ses activités. Pendant toutes ces années, Il avait assuré la rédaction régulière d’un Bulletin de liaison très utile qui, envoyé à toutes les sociétés composant l’ASPLF, les informait des activités de chacune. Sur ma proposition son épouse Nelly Robinet lui succéda. Pendant cette longue période d’une vingtaine d’années, nous nous sommes souvent retrouvés avec nos épouses, en Tunisie, en Italie mêlant agréablement les travaux et la visite des sites historiques. Et chacune de ces rencontres, à l’occasion de colloques et de congrès, donnait lieu à des échanges sur ses travaux pour lesquels il déployait une inépuisable énergie et où Leibniz tenait alors la place principale comme le montre la suite de ses ouvrages. Après la publication de ses deux thèses de doctorat, Système et existence dans l’œuvre de Malebranche (1965) et Malebranche et Leibniz, Relations personnelles (1955), son grand livre, Architectonique disjonctive, automates systémiques et idéalités transcendantales dans l’œuvre de Leibniz, Vrin 1986, demeure un classique de la compréhension d’une grande philosophie qui met en œuvre, sans sacrifier l’une à l’autre, la méthode génétique et la méthode structurale. Mais cet attachement aux grands maîtres ne l’a nullement empêché de s’intéresser à d’autres philosophes comme La Ramée qui fut l’objet de la thèse de son épouse, Dom Deschamps, Maine de Biran, Cournot, Péguy, de leur consacrer des travaux importants et même d’ouvrir en 2001 chez Vrin une collection originale, Pour Demain où il publia ses derniers ouvrages.
En 1993, alors que je n’avais pu, comme il l’avait souhaité, me rendre à Moscou, il me fit élire, à la place qu’il laissait vacante, au Conseil d’Administration de la FISP dont je fus ensuite élu premier vice-président au congrès de Boston en 1998 et où je suis resté actif jusqu’à celui de Séoul de 2008. Ainsi André Robinet me fit entrer et œuvrer dans ces deux associations internationales, l’ASPLF et la FISP, en lesquelles il avait joué pendant des décennies un rôle de premier plan.
Si j’essaie maintenant de dresser plus objectivement un portrait d’André Robinet, je dirais qu’il apparaissait d’abord comme un esprit libre pour lequel le penser par soi-même était une règle de vie, peu soucieux de respecter les modes d’où qu’elles viennent. Il se voulait français du terroir, très attaché à son village d’ Orchaise et à sa Vallée de la Cisse dans le Blésois dont il anima pendant des décennies le Syndicat d’initiatives qu’il avait fondé en 1962 avec un médecin de la région et dont, à la fin de sa vie, il avait réuni un grand nombre de cartes postales anciennes. C’était aussi un homme aux convictions politiques franches et bien arrêtées, avec des paradoxes langagiers qui pouvaient étonner certains de ses interlocuteurs. Il était capable d’intervenir durement dans les discussions, sans ménagement quand il le jugeait utile. Cette brusque franchise lui attira quelques inimitiés, y compris dans les domaines disciplinaires où son immense compétence ne pouvait être niée.
Pour ma part, j’ai été séduit d’emblée par sa démarche scientifique. Il fut un historien de la philosophie d’une extrême exigence, sa première recherche portait sur l’établissement des textes, comparant les différentes versions des manuscrits qu’il faisait figurer dans ses éditions des grands auteurs et qu’il allait rechercher dans les bibliothèques et universités étrangères, soucieux de découvrir des correspondances inédites, capables d’éclairer les textes d’une lumière nouvelle. Pour y répondre, il entreprit de grands voyages à travers l’Europe, de Hanovre à Berlin, de Bologne à Naples, nouant des liens d’étroite d’amitié et de travail, par exemple avec Hans Poser en Allemagne dans la Leibniz-Gesellschaft et avec Tullio Gregory en Italie en collaborant au Lessico Intellettuale Europeo de Rome. Jusqu’à la mort de l’académicien en 1994, André Robinet fut très proche d’Henri Gouhier qui préfaça plusieurs de ses ouvrages. Sa première grande initiative éditoriale, la publication des Œuvres complètes de Malebranche qui parut en 21 volumes chez Vrin de 1958 à 1965, année du 250e anniversaire de la mort du philosophe, sous l’égide du Centre national de la recherche scientifique dont il était alors maître de recherche, a été présentée par lui-même comme le résultat « de travaux d’équipe » qui supposaient le choix de collaborateurs entre lesquels il répartissait et coordonnait les tâches, « de travaux de recherche fondamentale » comme le prouvent l’apparat critique, les nombreux index, la réédition de textes jamais repris depuis leur première parution, « de travaux d’intérêt collectif » puisque l’utilisation de cette édition savante, destinée à figurer dans toutes les bibliothèques, est désormais l’outil privilégié de toute recherche sur Malebranche. C’est dans cet esprit, et avec les mêmes exigences, qu’il créa une collection aux Presses Universitaires de France sur le mouvement des idées au XVIIe siècle, utilisant les matériaux mis à jour par l’édition de Malebranche, privilégiant des philosophes moins connus comme Louis Thomassin et Bernard Lamy, qu’il entreprit ensuite de Bergson la publication des Œuvres (1959, Edition du Centenaire), d’un volume de Mélanges (1972), enfin de la Correspondance avec la collaboration de son épouse, chaque fois annotées avec soin, contribuant ainsi pour sa part à un retour à Bergson, alors quelque peu délaissé.
Cette exigence qu’on pourrait dire de la lettre l’a conduit à introduire en philosophie l’analyse lexicographique informatisée, devenue si précieuse pour les chercheurs. C’est ainsi qu’il l’appliqua lui-même au Discours de métaphysique et à la Monadologie de Leibniz, aux Méditations métaphysiques de Descartes, à la Profession de foi du Vicaire Savoyard de Jean-Jacques Rousseau et à quelques autres encore, ouvrant par là une voie extrêmement féconde pour l’interprétation des textes où il devient facile de repérer l’émergence et la place des concepts cardinaux d’un auteur. Il en résulta une collection chez Vrin, Philosophie et Informatique, qui a ouvert un champ nouveau à la recherche philosophique.
Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles, Directeur de recherche honoraire au Centre National de la Recherche Scientifique, André Robinet laisse une œuvre considérable qui a enrichi les travaux d’histoire de la philosophie du XXe siècle. Non seulement il a proposé une méthode en laquelle l’exigence scientifique est première, introduisant des techniques de lecture des textes ignorées jusque-là, mais, à partir d’elles, il a mis en œuvre une réflexion puissante, exprimée dans un style très personnel et quelquefois difficile, qui, bousculant certaines idées traditionnelles et dépassant l’opposition alors privilégiée entre synchronie et diachronie, a renouvelé la compréhension que l’on pouvait avoir de philosophes et de courants philosophiques, en particulier du XVIIe siècle. Sans doute faudra-il quelque temps pour mesurer, après son décès il y a quelques mois à peine (1), quel maître il fut et la place qu’il occupa, parmi les plus grands, dans la pensée contemporaine.
Jean Ferrari, président d’honneur de l’ASPLF
1 – Survenu le 13 octobre 2016.