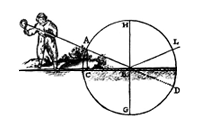De quel amour blessé Bernard Mabille s’en est-il donc allé, si loin et si violemment séparé de nous ? On a retrouvé son corps sans vie devant l’Institut de philosophie, à Poitiers, au petit matin du jour où les professeurs devaient faire leur rentrée des classes, le 1er septembre 2014. Mais n’était-ce pas lui qui nous avait appris à reconnaître dans la philosophie un geste, à la fois comme comportement et comme dit ? Comment pourrait-il en aller autrement de ce geste ultime, par lequel il montre à tout jamais leur borne auxnoirs vols du blasphème ? Mabille nous avait bien averti que le problème de la totalité est celui de son principe, et donc aussi, éventuellement, celui de son anarchie. Tel est le fil tendu dès sa grande thèse sur Hegel, » L’épreuve de la contingence « , parue en 1999. Dans son préambule, avant d’ouvrir la carte où il reporterait » les lieux » de la caducité (Zufälligkeit), il nous confiait à demi-mot (p. 11), l’existence de ce mal secret qui le rongeait déjà.
Il semble que la pensée de Mabille tournoie autour de l’énigme du sensible comme porteur de l’idéal de la raison, même si ces termes kantiens ne seraient peut-être pas les siens. Sa pensée ne pouvait manquer de prendre au moins l’une de ses sources dans le dialogue avec des poètes, tels Jacques Dupin ou Stig Dagermann, dans l’œuvre desquels on doit aussi apercevoir des kindred spirits. Mais ce n’est pas là qu’elle a commencé ; peut-être plutôt d’abord dans un engagement politique, là même où sa mort nous laissera. En 1994, Mabille a commenté les §§ 315 à 318 des Principes de la philosophie du droit à propos de ce que doit être et de ce qui doit être pensé de l’opinion publique, seul milieu où la liberté immémoriale de l’esprit ait à se déployer, par l’effort obscur de toute part, vers ce qui l’alimente et le fait croître ensemble, en le faisant devenir esprit concret. Non, le Hegel de Mabille ne fut pas celui de Kojève, ni celui des administrateurs naguère si soucieux de » préparer une opinion à accepter des décisions prises sans elle » (p. 189). Mais si la subjectivité moderne doit être approuvée parce qu’elle n’accepte rien qui ne soit » justifié « , elle est digne de mépris si son seul critère est la satisfaction de la particularité individuelle. Par son contenu, l’opinion touche à la profondeur du principe substantiel ; par sa forme, elle est alourdie par tout ce qu’elle a de particulier et qui fait d’elle la première figure, peut-être la plus épouvantable, de la contingence.
Mabille a défendu Hegel, en sa liberté de penseur spirituel, contre la pesanteur où l’entraînait le pieux et invétéré psittacisme de ses commentateurs, lequel fut bien utile aussi à ses adversaires, plus prompts à débiter leurs fadaises qu’à lire avec soin le philosophe qu’ils avaient choisi comme repoussoir. On ne peut toutefois réprimer le souci d’une correspondance étrange entre le geste accompli par Mabille pour mourir et celui de Deleuze, encore si près de nous. Mais peut-être la mémoire de Jules Lequier est-elle une ombre plus importante encore aux alentours de toutes ces disparitions. N’est-ce pas le risque majeur depuis Socrate : être emporté par la violence qui fait rage depuis toujours entre le Philosophe et la Cité ?
Mais le Hegel de Mabille reste le penseur de la liberté aux prises avec l’existence ; c’est là que certaines filiations secrètes avec la pensée de Schelling sont les plus visibles. Certes, Mabille sera fidèle au dictat de Hegel concernant le Schelling de l’identité en cette fameuse nuit où » toutes les vaches sont grises « . Mais si Mabille ne semble pas avoir évoqué la première esquisse, chez Schelling, du geste hégélien, il ne saurait l’avoir ignorée, et c’est une joie de reconnaître jusque dans le style impeccable et limpide de ses phrases classiques, le secret d’une formation que Schelling avait prise pour foyer de tout son intérêt philosophique.
Une telle énigme ne commence peut-être ni avec Leibniz seulement, ni même avec Jakob Böhme, mais remonte sans discontinuer jusqu’à la Grèce de Socrate et Platon. Tel est le deuxième grand » battant « , au sens des deux montants verticaux d’une fenêtre » à la française « , de l’œuvre de Mabille : la confrontation avec la pensée de Heidegger.
Cette confrontation a lieu d’abord pour conjurer une dernière fois les ultimes calomniateurs de Hegel, qui, le sachant ou non, s’autorisaient en fait de la pensée de Heidegger pour développer leurs propres concaténations de » pensées d’entendement « . Loin de tout face à face immédiat, le second grand livre de Mabille consiste à » intensifier deux lectures internes par le défi aporétique qu’apporte la position de tiers « ((Hegel, Heidegger et la métaphysique, Recherches pour une constitution, p. 28.)). Aurions-nous jamais pu retrouver la signature de Mabille ailleurs qu’en ce geste inoubliable de défi, en vue d’une constitution ? Et sous le titre de constitution, l’enjeu n’est-il pas clairement d’aider à discerner le bien commun, celui qui est en débat quand il s’agit de délibérer avec prudence ? Uneconstitution (Verfassung) désigne ce qui, aujourd’hui, dans tous les domaines, nous fait le plus grave défaut : un contenant essentiel (Fass), une capacité qui nous permette de vivre et donc de penser ensemble. La métaphysique doit nous permettre de repenser au principe, en tant que réminiscence, et aussi en tant qu’invention, comme Mabille nous l’aura si clairement enseigné dans sa lecture de Hegel. Et sur ce point, nous ne pouvons plus répéter, avec cette équivoque si particulière à Heidegger, que » tous les philosophes ont pensé lemême, et que c’est pour cela que leur pensée est en conflit ».
Contre Heidegger, Mabille nous enseigne à lire la tradition autrement que pour » en libérer l’impensé « , c’est-à-dire autrement que sur un mode dogmatique (p. 370). » La relation avec la tradition est une libération « , écrit Mabille. Il s’agit de distinguer deux conceptions différentes du temps : l’une, celle de Hegel, correspond au primat du présent ; l’autre, celle de Heidegger, au primat de » l’avènementiel « . L’une nous permet de penser l’unité de la pensée humaine, l’autre au contraire nous l’interdit. Le problème central concerne donc le sens de l’histoire, celle des hommes et aussi celle de la philosophie. Heidegger au fond, replie Hegel sur Leibniz en l’accusant d’éliminer la temporalité » dans un processus historique qui n’est que la forme narrative de l’éternité ». Hegel au contraire fait de la temporalité » le milieu de la présentation du vrai », et c’est avec le sens de cette limite essentielle que Mabille s’explique.
Mabille écrivait en faveur d’une nouvelle constitution de la métaphysique, par un geste où nous devons reconnaître celui de la liberté philosophique autant que du courage politique et simplement humain. Comment ne pas souhaiter qu’une telle œuvre témoigne toujours et pour le plus grand nombre en faveur de la philosophie éternelle qu’elle aura servie avec une telle liberté ?