Conférence du 21 janvier 2017, Sorbonne, amphithéâtre Edgar Quinet
par Elhanan Yakira

Il y a sans doute une énigme spinoziste. Elle persiste en dépit du vaste corpus, qui, consacré à la philosophie ou à la vie du philosophe, ne cesse de croître en quantité comme souvent aussi en qualité. Qui fut ce penseur étrange et solitaire ? Qu’a t-il voulu au juste ? Comment comprendre l’intérêt dont il fait l’objet et son influence sur la pensée moderne, voire sur la culture moderne elle-même ? Mais surtout, peut-on trouver dans sa pensée un intérêt non pour les érudits ou les historiens, ni en vertu d’inspirations vagues, mais pour des raisons proprement philosophiques ? Il m’a semblé devoir apporter une réponse positive à cette question.
Quantité de préoccupations spinozistes semblent, à un titre ou un autre, pleinement ou partiellement, faire désormais partie intégrante des visions modernes du monde. C’est le cas notamment de sa doctrine de l’Etat et du politique ; c’est également le cas de ses vues en matière de rationalité scientifique, de la scientificité possible de l’approche de la psyché et des affections. On pourrait sans doute nommer beaucoup d’autres points. Pourtant, sa doctrine de la liberté par exemple, ou encore cette chose plutôt obscure et même mystérieuse, qu’il appelle béatitude, restent opaques pour la plupart de ses lecteurs contemporains. D’un autre côté, sa théorie des rapports entre le corps et l’âme paraît à beaucoup détenir une grande valeur du point de vue des sciences de la vie comme des neurosciences telles qu’elles sont pratiquées de nos jours ; en vérité toutefois n’est-ce pas à la faveur d’une lecture partiale qui veut attribuer à Spinoza, sans doute à la suite de Fechner, une doctrine « paralléliste » alors que cette dernière est bien davantage leibnizienne que spinoziste ? Ce qui ne serait pas le seul cas d’une lecture plus ou moins « leibnizienne » de Spinoza.

Le véritable et vivant intérêt philosophique de Spinoza se trouverait ailleurs. On ampute Spinoza à omettre que c’est sa conception éthique en laquelle gisent le noyau, le cœur, la source thématique, conceptuelle, existentielle peut-être, d’où émerge ce qu’on appelle le système spinoziste ; c’est cela plus que toute autre chose qui lui donne son ultime intelligibilité philosophique. Deux traits donnent à cette éthique son visage spécifique, voire unique : sa nature iconoclaste d’une part, et d’autre part, le statut de vérité absolue, démontrée more geometrico, que Spinoza pense pouvoir lui octroyer. Car en général, et depuis le temps des grecs, on distingue entre la nécessité ou les vérités morales et la nécessité ou vérité des mathématiques.
N’insistons pas sur la critique radicale que mène Spinoza à l’égard des religions révélées et instituées, car il y a là un lieu commun. Or, chez Spinoza la critique radicale de la religion s’entrelace avec l’élaboration positive de l’éthique. Ces deux éléments se conditionnent l’un l’autre et ne peuvent être séparés qu’au prix de perdre de vue la spécificité de l’entreprise spinoziste. En entrelaçant la polémique contre « la » religion avec sa doctrine éthique positive, Spinoza aboutit à un paradoxe : sa philosophie s’affirme comme une alternative à part entière à la religion, ce qui signifie à la fois un rejet de tout ce qui relève de la tradition religieuse, mais aussi une reconnaissance plus ou moins implicite, mais tout à fait réelle, de la pertinence des motivations présumées du religieux, plus précisément de la quête de certitude morale. Tout en n’étant pas dépourvue du profond « sérieux » caractéristique de l’attitude religieuse, cette philosophie se livre à une déconstruction sans compromis de ce qu’elle prend pour le contenu des religions positives. En d’autres termes, si la philosophie de Spinoza est initiée par le rejet radical de tout ce qui relève du « religieux », elle n’en retient pas moins l’absoluité de la normativité, l’irréductibilité des normes éthiques fondées cette fois, non plus sur la révélation mais sur la raison.
Pour essayer de reconstruire le sens positif de l’éthique spinoziste, je procèderai en deux temps.
D’un côté, je prendrai comme point de départ la théorie spinoziste de l’âme et du corps. Celle-ci est interprétée le plus souvent comme une théorie « paralléliste ». Or, le parallélisme est une invention leibnizienne conçue, ironiquement, dans le contexte de sa critique du spinozisme. Je soutiendrai que la conception de Spinoza de l’âme et du corps est une conception non paralléliste, voire anti-paralléliste. A son centre se trouve cette étrange doctrine selon laquelle l’âme est l’idée du corps. Souvent mentionnée mais rarement étudiée au fond, c’est cette doctrine certes profondément contre intuitive et même paradoxale, qu’il faudrait essayer de déchiffrer. Plutôt qu’une contribution supplémentaire à la problématique cartésienne des rapports entre l’âme et le corps, elle fournit, croyons-nous, le fondement de l’éthique spinoziste qui est une éthique de l’absolument incontournable hic et nunc. En rejetant ainsi toute croyance en l’immortalité, liberté, certes, mais aussi éternité et béatitude, acquièrent une consistance proprement philosophique.
Le deuxième temps sera abordé en faisant appel à la lecture éthique que fit Jean Cavaillès de la notion spinoziste de nécessité. A l’encontre de cette lecture toutefois, je ne comprendrai pas cette nécessité comme un appel direct à l’action ou à la résistance, mais bien plutôt comme une réduction originelle de l’éternité à la nécessité, qui dessine le visage d’une philosophie de la valeur absolue de l’existence elle-même.
Elhanan Yakira est professeur émérite à l’université hébraïque de Jérusalem.
La conférence a été suivie d’une intervention d’Edith Fuchs, traductrice de : Elhanan Yakira, Spinoza. La cause de la philosophie (Paris : Vrin, 2017).
Conférence, intervention d’Edith Fuchs et discussion publiées dans le Bulletin n° 2017 111 1.
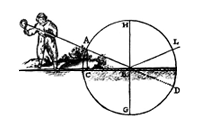

 l’animalité, rangeant l’homme dans le genre animal, avec la raison comme différence spécifique, et de là serait venu le biologisme. Foucault lui aussi prétend que cette définition règne depuis 2000 ans en occident, mais ne lui donne pas ce sens. Ce ne sont que quelques exemples.
l’animalité, rangeant l’homme dans le genre animal, avec la raison comme différence spécifique, et de là serait venu le biologisme. Foucault lui aussi prétend que cette définition règne depuis 2000 ans en occident, mais ne lui donne pas ce sens. Ce ne sont que quelques exemples.
 La philosophie politique s’est constituée comme une interrogation sur la justice, culminant dans la recherche du « meilleur régime ». Cette interrogation « naturelle » a reçu une inflexion décisive lorsque les Modernes ont formé le projet inédit de résoudre une fois pour toutes la question de la justice en concevant le meilleur régime non comme le régime le plus juste mais comme le régime le plus libre. On s’interrogera sur les suites politiques et spirituelles de cette décision.
La philosophie politique s’est constituée comme une interrogation sur la justice, culminant dans la recherche du « meilleur régime ». Cette interrogation « naturelle » a reçu une inflexion décisive lorsque les Modernes ont formé le projet inédit de résoudre une fois pour toutes la question de la justice en concevant le meilleur régime non comme le régime le plus juste mais comme le régime le plus libre. On s’interrogera sur les suites politiques et spirituelles de cette décision.



